Le 2 décembre dernier, c’était la 69e édition de la mythique Sainté-Lyon. 78 km au départ de la capitale du Forez pour rejoindre la capitale des Gaules à travers les Monts du Lyonnais (2 300 m D+).
Mica était au départ avec son pote Laurent. Il nous raconte avec froideur leur aventure.
La Sainté-Lyon pour moi
Né à Saint-Étienne (hé ho, on ne choisit pas son lieu de naissance ! J’ai juste eu beaucoup de chance, je n’y peux rien) et ayant grandi dans le Forez (ça se prononce « forêt », pas « forèze » !), la Sainté-Lyon est une course dont j’entends parler depuis tout petit.
Quand on évoque ce trail, les images qui me viennent en tête sont celles que je voyais au journal télévisé de France 3 Région (FR3 à l’époque) les lendemains de course : des gens habillés chaudement qui courent sous les flocons ou la pluie ; dans la neige ou dans la boue, mais dans tous les cas une lampe vissée au front. Je m’étais dit dans ma jeunesse sportive que je ferai un jour cette course et j’ai finalement attendu mes 42 ans pour m’y inscrire. Il ne restait plus qu’à la préparer pour prendre le départ avec mon pote (et partenaire de CO) Laurent. Lui avait déjà tenté l’aventure il y a quelques années mais avait dû abandonner après une grosse entorse à la cheville au tiers de la course.
La préparation de la Sainté-Lyon
Après un GRP Tour du Moudang rondement mené (hum), j’ai voulu surfer sur ma préparation estivale pour me présenter au départ de la Sainté-Lyon en jambes (avec mes jambes à moi, hein, c’est pas non plus des guiboles de compétition que je voulais). J’ai alors attaqué le mois de septembre avec 2 à 3 sorties courtes par semaine, dont la séance hebdomadaire du mardi avec coach Simon. Tout allait bien et la fatigue liée au GRP ne se faisait pas trop sentir.
Alors que j’envisageais d’augmenter petit à petit les distances, une douleur au tibia droit fit son apparition soudainement pendant que je me rendais vers la désormais habituelle séance du mardi. Assez intense mais tolérable, la douleur ne m’empêcha pas de faire la séance. Toutefois, le lendemain, je n’arrivais plus à poser le pied par terre et commençais à m’inquiéter pour la suite des événements. Quelques jours après, le diagnostic fut posé, implacable : fracture de fatigue. Aïe.
Selon le kiné, à deux mois de l’échéance, prendre le départ restait envisageable mais il fallait, pour cela, ne pas courir (ou très peu) d’ici la date fatidique. Préparer une course exigeante sans courir ou remettre ça à plus tard ? Tel fut mon questionnement. Après quelques jours de réflexion, je décidais de tenter ma chance malgré tout, quitte à devoir abandonner en cours de route. J’ai donc fait la préparation de la Sainté-Lyon sans courir (ou presque) : pour le cardio : de la natation (beaucoup) et du vélo (un peu) ; pour les jambes : du renforcement musculaire quasi-quotidien. Et advienne que pourra.
La plus grosse difficulté de la Sainté-Lyon
35 km de crawl, 200 km de VTT, 10 000 squats et autres fentes plus tard, je m’aligne donc au départ de cette Sainté-Lyon (69e du nom) sans avoir couru depuis deux mois, à l’exception de la première CO du Challenge et deux petites sorties de 30 minutes.
Quand on demande à celles et ceux qui ont déjà pris le départ d’une Sainté-Lyon ce qui présente la plus grande difficulté de cette course, les réponses tournent généralement autour des conditions météorologiques. Bien sûr, courir des heures sous la pluie, le vent, la neige (parfois les trois à la fois) dans un froid certain quasi-polaire ressemble à une gageure.
D’autres vous diront que tout ça serait surmontable avec une distance moindre.
D’aucuns mentionneront la nuit comme principale difficulté.
Quelques farfelu·es vous assureront que le climat, la distance, la nuit sont des accrocs de taille, certes, mais que c’est le dénivelé sans bâton qui a eu raison d’elles et eux.
Pourtant, ce qui est clairement le plus difficile se situe dans le concept même de la Sainté-Lyon : le sens de parcours ! Aller de Saint-Étienne à Lyon, quelle idée ? Pourquoi voudrait-on quitter la chaleureuse et amicale Saint-Étienne pour rejoindre l’hostile et antipathique Lyon ? (Quoi ? Moi chauvin ? Au mieux un imbécile heureux né quelque part).
Mais trêve de bla bla (qui a dit « enfin ! » ?), parlons de cette 69e édition de la Sainté-Lyon.
De Saint-Étienne à Saint-Christo-en-Jarez : 19 km de bonheur
Pour cette édition de la doyenne des trails, pas de pluie, pas de neige (enfin, pas de neige tombant du ciel pendant la course) mais une température un peu plus fraîche qu’à l’accoutumée : -4 °C au départ et quelques -11 °C annoncés (ressentis -15 °C paraît-il) pendant la nuit. Même bien habillé et solide face au froid (j’ai une couche protectrice secrète – norme ISOraclette2000 ! – que je garde toujours très près du corps), attendre le départ près d’une heure dehors avec les quelque 17 000 autres participant·es fut déjà un premier passage à surmonter pour ne pas voir les pieds geler dans les chaussures.
Avec Laurent, on réussit à partir dans le sas 2 (le premier sas est réservé aux élites/performances et autres coureuses et coureurs de la Lyon-Sainté-Lyon), tant mieux car ça nous permet d’avoir 45 minutes de plus que les dernières personnes à quitter la ville verte pour passer les barrières horaires.
Laurent décide de faire la course « avec » moi. Bien meilleur coureur que moi (qui ne l’est pas ?), il estime ne pas être suffisamment préparé pour partir comme il le fait toujours : beaucoup trop vite ! Son seul objectif au départ : être à l’arrivée, dut-il la rejoindre en terminant en queue de peloton en ma compagnie. Il me propose d’ailleurs de lui donner le tempo et de me suivre. Ah ah, j’en rigole intérieurement sachant très bien qu’il sera incapable de rester derrière moi très longtemps. Pas manqué, après environ 8 mètres (bon, d’accord, peut-être un peu plus), il est déjà devant moi et me dit d’aller à mon rythme, qu’il m’attendra plus loin. « Stratégie » qu’il maintiendra toute la course, y compris durant les périodes les plus froides (toute la nuit, en résumé).
Pour moi, les premiers kilomètres sont rassurants. Malgré l’absence d’entraînement en course à pied, je me sens bien. Aucune douleur au tibia et des jambes qui répondent bien. Je vais à mon rythme (même un peu plus vite que d’habitude) et je prends énormément de plaisir sur ces routes stéphanoises que je connais bien.
Les 19 premiers kilomètres se passent à merveille. C’est plutôt roulant sur la première moitié et ça monte gentiment ensuite jusqu’à Saint-Christo-en-Jarez (premier ravito) où on arrive avec près de 2 heures d’avance sur la barrière horaire. La principale difficulté de ce premier morceau est le verglas qui est déjà très présent dès qu’on passe sur des routes goudronnées qui n’ont pas été salées. La plupart des coureuses et coureurs préfère avancer sur l’herbe en bord de route plutôt que sur le bitume gelé. Dans les premières descentes verglacées, je vois plusieurs de mes congénères tomber et je ris intérieurement de leurs déboires : “franchement, ça se voit que ça glisse, quelle bande de débiles à vouloir aller aussi vite sur un sol pareil…”
En tout cas, j’arrive à Saint-Christo-en-Jarez sans avoir chu et avec encore pas mal d’énergie à dépenser.
De Saint-Christo-en-Jarez à Sainte-Catherine : 14 km de neige et de verglas
Je profite du ravito de Saint-Christo pour m’hydrater (notamment avec de la soupe). C’est d’autant plus important que l’eau dans le camelbak a gelé (malgré la protection sur le tuyau) et que ce dernier est désormais inutilisable. Pour boire en course, j’utilise ma flasque dont je dévisse le goulot pour essayer de trouver de l’eau liquide sous la glace.
Il est près de 2 h 45 quand on quitte le ravito de Saint-Christo-en-Jarez en direction du check-point suivant situé à 14 km et 500 m de D+ : Sainte-Catherine (haut lieu de l’abandon de la Sainté-Lyon apparemment). Il fait froid et on voit plusieurs camarades de course s’arrêter près des feux allumés sur le bord de la route par des spectateurs et spectatrices (nombreuses et nombreux malgré l’heure tardive) pour se réchauffer les doigts ou tenter de récupérer de l’eau liquide dans leur camelbak.
Sur ce morceau de parcours, on a plusieurs fois l’occasion de courir dans la neige. Et c’est agréable (en tout cas pour moi) : ça ne glisse pas, ça ne rentre pas dans les chaussures, ça ne colle pas aux pieds, ça rend le terrain très souple.
Oh, le verglas est toujours là, certes, entraînant son lot incalculable de chutes de la part des autres concurrent·es. Vraiment, je me demande pourquoi ils ne vont pas moins vite au lieu de… BOUM ! Je n’ai pas le temps de terminer ma réflexion que me voilà à mon tour les quatre fers en l’air pour la première fois. Et, rapidement après, pour la deuxième puis troisième fois.
Je vous spoile la suite : sur l’ensemble de la course, je finirai au tas pas moins (mais peut-être plus, j’ai arrêté de compter au bout d’un moment) de 11 fois ! Je suis catégorique : nos nouvelles vestes imperméables estampillées Raid’Apte sont solides : pas un trou, pas une éraflure malgré des descentes directes sur les coudes, les épaules, le dos.

La fin de parcours vers Sainte-Catherine commence à être pesante car le sommeil s’empare de moi (et chaque chute mine un peu le moral). Dès que je peux courir, ça me réveille mais j’ai du mal à garder les yeux ouverts lors des passages – nombreux – où l’on marche à pas lent pour cause de verglas.
Comme prévu, Laurent m’attend à l’entrée du ravito et on passe une nouvelle fois la barrière horaire avec à peu près deux heures d’avance. Si tout se passe bien, le prochain ravito aura lieu de jour. Youhou !
De Sainte-Catherine à Le camp-Saint-Genou : 12 km de chutes et de whaou !
Comme lors du premier arrêt, on ne traîne pas au ravitaillement afin de ne pas être pris par le froid. Quelques bols de soupe, un bout de fromage et nous voilà repartis pour 12 km qui devraient se terminer en plein jour. Et les étoiles au-dessus de nos têtes nous laissent espérer une matinée resplendissante, de quoi se réchauffer le moral quand la fatigue commence à se faire sentir.
Dans ma mémoire, ces 12 km ressemblent aux 14 précédents (avec le jour pointant le bout du nez): du verglas, de la glace, des terrains gelés, des chutes et, parfois, un peu de course dans la neige (génial !). Quand on se renseigne sur le revêtement de la Sainté-Lyon, on a tendance à lire que c’est 60 % de chemins (parfois caillouteux) et 40 % de bitume. Pour cette édition, on était sur du 40 % routes et chemins (parfois boueux ou enneigés), 60 % patinoire.
L’état du terrain est tellement peu propice à la course à pied que des chemins alternatifs se créent dans les champs alentour dès que la géographie le permet. Ça ne dure jamais longtemps mais c’est chaque fois un bonheur de courir en descente dans la neige, sans risquer une lourde chute et sans trop réfléchir où on met les pieds.
Au lever du soleil, nous sommes au point culminant de la course et des Monts du Lyonnais : le Signal de Saint-André-la-Côte (934 m d’altitude), dans un paysage enneigé surplombant les Monts du Lyonnais. Le spectacle est grandiose et le belvédère près du signal est pris d’assaut par les concurrentes et concurrents qui défient le froid pour en prendre plein la vue.

Quelques bornes plus loin, une nouvelle pente verglacée a raison des plus vaillants et des plus courageuses : si je décide de descendre sur le bord du chemin en m’accrochant tant bien que mal aux branches de la dense (et piquante) haie, la plupart de mes compatriotes décident de faire la descente sur les fesses, fatigué·es probablement des chutes à répétition.
Si une personne qui a fait la Sainté-Lyon 2023 vous dit ne pas être tombée, soit elle ment, soit elle affabule, soit elle galèje. Ou alors, vous êtes en train de parler à Surya Bonaly.
De Le Camp-Saint-Genou à Soucieu-en-Jarez : 13 km de jour… et de verglas (encore)
L’arrivée au troisième ravito (Le Camp-Saint-Genou) se fait sous un ciel bleu et un beau soleil. Les températures commencent à remonter et on espère en avoir terminé avec le verglas. Mais non, on en aura quasiment jusqu’à la fin même s’il est moins dérangeant sur les 30 derniers kilomètres qui se font en grande partie sur des petites routes bitumées.
Entre Le Camp-Saint-Genou et Soucieu-en-Jarez, les “premiers” (sic) signes de fatigue musculaire commencent à se faire ressentir. J’ai moins de jus en montée et je peine à courir dans les descentes dès qu’elles sont trop pentues. Il me tarde d’arriver à Soucieu-en-Jarez car je sais que le ravito est dans un gymnase (jusque-là, les ravitaillements étaient en extérieur, servis par des bénévoles – qu’il est grand temps de remercier – installés sous des tivolis). Je propose à Laurent, lorsque je le rejoins au soleil où il m’attend qu’on prenne 10-15 minutes pour se poser à Soucieu quand on y arrivera.
De Soucieu-en-Jarez à Chaponost : 7 km à “vive” allure
Finalement, en arrivant à Soucieu-en-Jarez, on apprend que le ravitaillement suivant sera aussi dans un gymnase. Décision est donc prise de repartir très vite (enfin, façon de parler) pour quelque 7 km qui devraient passer assez rapidement (on ne va faire que descendre ou presque). De toute façon, la seule chose qui aurait pu nous retenir plus longtemps, c’était le saucisson promis… et il n’y en avait plus ! Bon, n’allez pas croire que j’ai tenu près de 60 bornes sans un bout de sauciflard, j’avais bien entendu ma réserve personnelle.
Sur ces 7 kilomètres, je cours une bonne partie du temps, dont les 3-4 premiers kilomètres. Je suis, certes, déjà bien fatigué mais j’ai encore un peu de jus pour trottiner dans les faux plats descendants – nombreux – qui se présentent… En revanche, toute pente (descendante) un peu trop ardue me rappelle ardemment l’existence de mes quadriceps. Mais ce passage entre Soucieu et Chaponost est plaisant : le temps est superbe et le terrain favorable (ça descend gentiment sur des petites routes goudronnées). Ça permet de faire passer “rapidement” (1 h 15) la distance restante de 20 km à 13 km.

De Chaponost à Lyon : 13 km pour arriver (dont 10 km de calvaire)
À Chaponost, je propose donc à Laurent de prendre un peu plus de temps qu’aux autres ravito. Déjà, parce qu’il y a du saucisson (enfin !), mais surtout parce que je sens que les derniers 13 km seront difficiles : j’ai besoin de m’y préparer mentalement et physiquement (des douleurs au pied commencent à arriver pour accompagner des quadriceps qui chauffent désormais au moindre terrain descendant, aussi douce soit la pente).
On a encore pas loin de deux heures d’avance sur la barrière horaire, on profite donc d’un petit moment de réconfort entre soupe et charcuterie avant de reprendre la route tant bien que mal (pour moi, Laurent est plus frais, lui).
Cette dernière partie de course m’aurait certainement paru jolie et agréable (traversée de cours d’eau, passage dans des sous-bois sur des chemins un peu boueux mais pas trop…) si je n’avais eu si mal aux jambes après 3 km.
Sur les 10 dernières bornes, chaque pas est douloureux et je me répète à l’envi le leitmotiv de notre président (celui de Raid’Apte, hein) : “quand on est dans la difficulté, chaque pas de plus est un pas de moins à faire”. Mes quadriceps me font tellement souffrir que je dis à Laurent que je préfère désormais les montées aux descentes. Même avec ce qui nous attendait à 6 kilomètres de l’arrivée : alors qu’on pensait en avoir terminé avec le dénivelé positif, se présente une montée avec une pente moyenne de près de 12 % (19 % par endroit !), les derniers (ou presque) 105 m de D+ pour un peu moins d’un kilomètre de montée (bon, en vrai, ce n’était pas une surprise, cela faisait un petit moment que les coureuses et coureurs autour de moi parlaient de cette montée, impatient·es de la passer car elle représente pour beaucoup la dernière grosse difficulté de la course).
Probablement fatigué de m’attendre, Laurent décide de m’aider à grimper cette côte en me poussant. Mais cela ne fait qu’accroître mes douleurs aux quadriceps. Les montées, je gère (lentement, mais je gère). Non, mon souci, depuis 4 kilomètres, c’est vraiment la descente. Et comme il va falloir arriver en bord de Saône (puis de Rhône), pas de doute, il devrait en rester quelques-unes (faut pas chercher à me baiser sur la géo).
Si la descente de l’accrobranche de Sainte-Foy-lès-Lyon ne se fait pas de gaieté de cœur, elle reste surmontable. C’est après, quand la pente est plus ardue que je commence à descendre en marche arrière (véridique), sous les (sou)rires amusés des concurrent·es qui me doublent et me croisent en même temps. Mais le summum de cette interminable descente vers la capitale des Gaules arrive 2-3 kilomètres plus loin avec les marches du chemin du grapillon à La Mulatière…
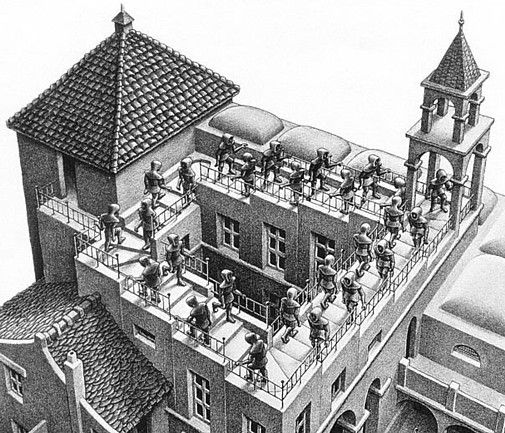
Comment vous dire… ? Vous vous rappelez du lendemain de votre toute première séance de pont de votre vie ? Vous vous souvenez de cette petite marche que vous deviez descendre pour sortir de chez vous ou vous rendre à la machine à café du bureau ? Vous arrivez à vous remémorer ce petit calvaire que représentait cette marche à descendre ? Et bien, les marches de la Mulatière, pour moi, c’était ça, mais 200 fois et avec 75 bornes dans les pattes ! Enfin, 200 fois, c’est ce qu’on nous dit dans le programme officiel. Je mentirais si je disais que je les ai comptées, mais si je devais donner une estimation, je dirais qu’il y en a un peu plus (environ 11 000).
D’ailleurs, c’est à la fin de sa première Sainté-Lyon que M.C. Escher eut l’idée de son œuvre Montée et descente (true story).
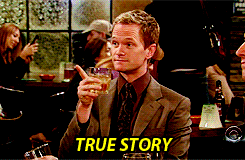
En bas des marches, il reste trois kilomètres pour enfin passer l’arche d’arrivée en compagnie de Laurent qui m’attend encore pour qu’on termine cette belle aventure ensemble… À Lyon (bon, en vrai, j’aime bien Lyon, mais ne le dites pas à mon Père).
En guise de conclusion
Je ne sais pas si on peut parler d’une belle journée, ou d’une belle nuit. J’ai bien envie, en tout cas, de parler d’une journée de fou.
(pour la traduction, contactez-moi)







Laisser un commentaire
Vous devez être identifié sur pour poster un commentaire.